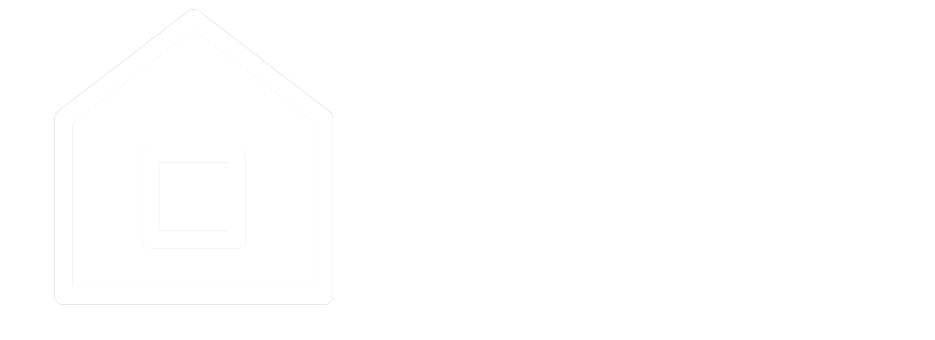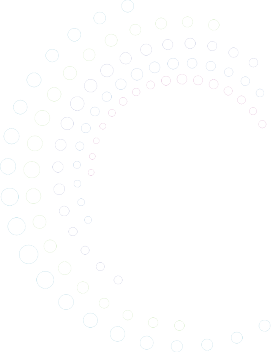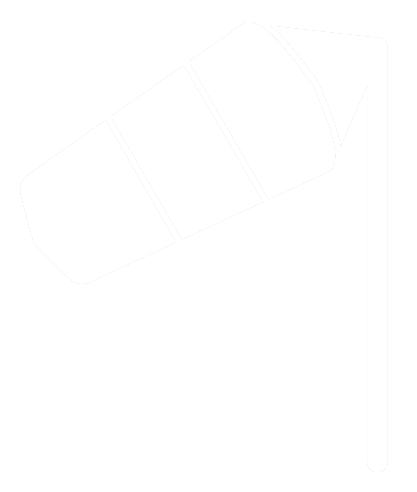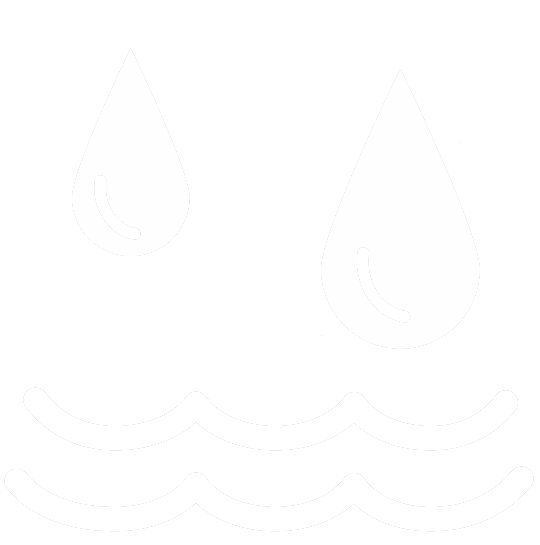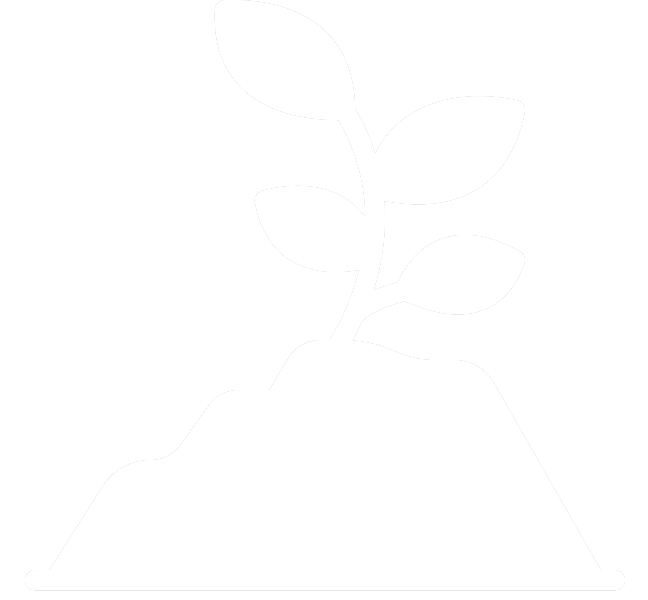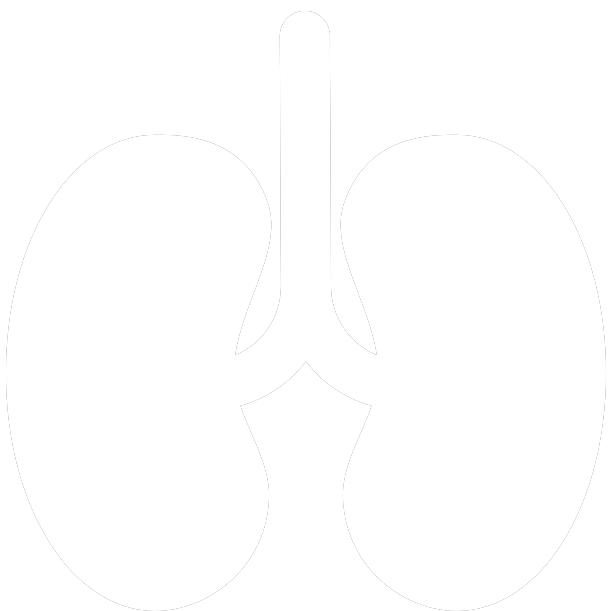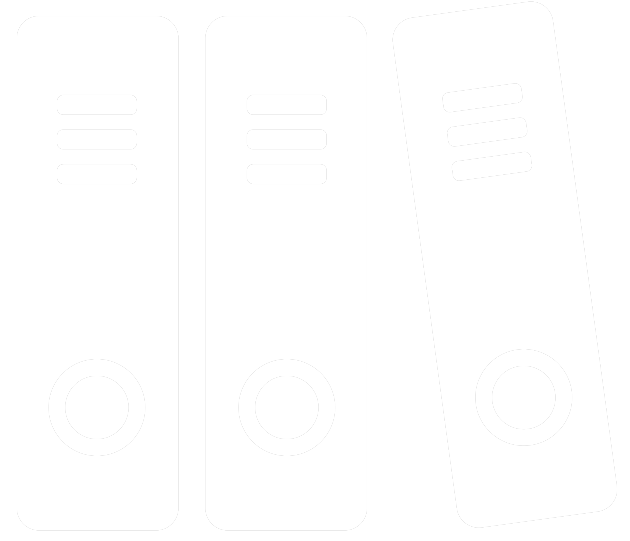L'institut
L'Institut écocitoyen est une association dont les missions principales sont l'acquisition de connaissances scientifiques autour des questions sanitaires et environnementales, la transmission de ces savoirs et l’organisation d’actions de surveillance et de protection de l’environnement. Pour la première fois, citoyens, élus, industriels et scientifiques collaborent à un projet commun à l'échelle d'un territoire.